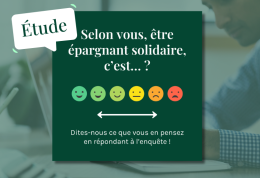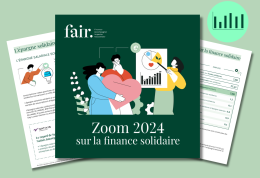3 questions à Marie-Laure Barut-Etherington, Directrice générale adjointe, Banque de France
Publiée le 18.02.2025
Comment avez-vous connu les fonds solidaires et pourriez-vous nous partager votre vision de la finance solidaire ?
Il se trouve qu’un des postes que j’ai occupé il y a quelques années, était celui de Directrice Générale de BDF-Gestion, la société de gestion d’actifs filiale de la Banque de France (d’ailleurs le seul cas dans le monde d’un asset manager adossé à une banque centrale). Cette société gère, pour l’essentiel, les capitaux patrimoniaux de la Banque de France ainsi que les Fonds Communs du Plan d’Épargne d’Entreprise (FCPE) de ses collaborateurs.
En 2018, nous avons souhaité doter notre fonds d’épargne solidaire du label Finansol, afin de renforcer la visibilité de ce fonds et de le distinguer des autres produits classiques. J’ai donc pu suivre pas à pas le processus de labellisation et en constater l’exigence, en particulier pour la part « non solidaire » qui, en cohérence avec la philosophie de gestion de la poche solidaire, a adopté des critères ESG stricts. À ce propos, nous accueillons chaleureusement les évolutions du règlement du label dont les normes se rapprochent de celles soutenues par la Banque de France dans sa charte d’investisseur responsable. L’obtention de l’agrément pour gérer des actifs non cotés n’a pas été facile non plus. Mais ce label est un formidable outil de communication vis-à-vis des épargnants. Ce gage de rigueur et de transparence de la gestion que nous avons pu mettre en avant, nous a permis de rehausser nettement l’encours du fonds depuis 2019.
Comment expliquer la place marginale qu'occupent les fonds solidaires ?
Je pense que beaucoup d’épargnants cherchent à donner du sens à leur épargne, en particulier leur épargne de long terme. Mais ils n’ont pas toujours le temps de s’informer, ni l’expertise nécessaire pour juger de la pertinence des multiples supports, comprendre la différence entre les labels, évaluer si les stratégies de gestion correspondent à leurs besoins… Les études ou enquêtes montrent d’ailleurs qu’il y a un écart très significatif entre la part des investisseurs qui estiment qu’il est vraiment important que l’épargne finance des projets responsables, durables ou à impact (plus de la moitié des personnes interrogées quel que soit le sondage) et la réalité des encours sur cette catégorie de produits financiers. Comment alors améliorer le « passage à l’action » ?
On constate qu’une bonne façon de faire progresser ce type d’épargne, c’est d’avoir une stratégie d’influence sur le comportement des épargnants, ce que les anglo-saxons appellent le nudge. Ça peut être réglementaire : si près de 90% de l’épargne solidaire en fonds « 90 / 10 » est portée par l’épargne salariale, on le doit à la loi de 2008, rentrée en vigueur en 2010 et qui a rendu obligatoire la présence d’au moins un fonds solidaire dans les plans d’épargne salariale. On peut espérer que la même obligation, qui s’adresse désormais aux contrats d’assurance vie depuis 2022, dynamisera ce type de placement. Ça peut être aussi plus « technique » : le « coup de pouce » de l’entreprise (pour l’épargne salariale) ou du gestionnaire (pour l’assurance-vie et le PER) qui propose une allocation « par défaut » de l’épargne salariale, ou qui inclut automatiquement un fonds solidaire dans les contrats en gestion pilotée, en informant bien sûr l’épargnant qui garde la possibilité de modifier ce choix.
À votre avis, quels sont les défis que l'écosystème de la finance solidaire pourra rencontrer dans un futur proche, par exemple un niveau réglementaire ?
Le terme « solidaire » n’est pas forcément clair. Ce n’est pas intuitif, si on n’est pas un peu initié, de savoir ce que recouvre cet adjectif. Il est donc primordial de diffuser un maximum d’information sur les fonds solidaires à l’intention des épargnants et des futurs épargnants. Et cette information peut être davantage ciblée qu’aujourd’hui. D’après les sondages, on voit par exemple que les jeunes sont plus sensibles à ces valeurs de solidarité sociale pour leurs placements, et les femmes seraient également plus nombreuses que les hommes à vouloir orienter leur épargne vers ce type de support. Il faut aussi et surtout arrêter de traiter ces produits comme des supports « à part » : les fonds solidaires doivent faire partie de la palette « standard » proposés aux ménages pour leur épargne, leurs performances étant tout à fait comparables à celles des fonds basés sur le même univers d’investissement, surtout lorsque l’horizon de détention est à moyen ou long terme. La poche solidaire a un effet de diversification et de « coussin » contracyclique en cas de mauvaise performance des marchés. Il faut sortir du discours « c’est bien mais ça peut rapporter moins » et les promouvoir en disant « c’est mieux et ça peut rapporter autant ».